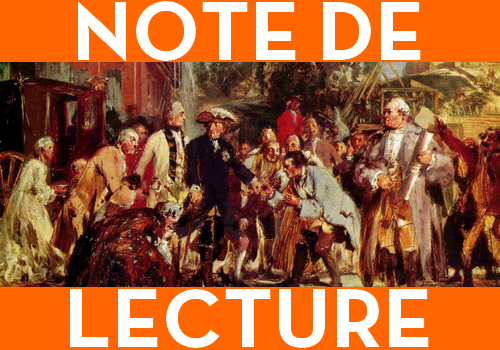
À la suite de notre chronique littéraire, retrouvez dès à présent nos notes de lecture de l’ouvrage « Le despotisme éclairé », par François Bluche, ainsi que quelques extraits marquants.
- CLIQUER ICI pour télécharger cette note de lecture (PDF)
► Précisions sur l’auteur
Tout connaisseur de la monarchie de Louis XIV a un jour entre ses mains l’imposant ouvrage consacré au Grand roi par François Bluche (1925-2018). Ce dernier oriente sa carrière universitaire vers la redécouverte de l’Ancien Régime, surtout l’étude du Grand siècle, auquel il consacre un riche dictionnaire.
Bien que proche des milieux de gauche et protestant lui-même, il se donne pour motivation de comprendre et de faire comprendre les rouages complexes de l’État monarchique — notamment ceux des parlements — aux temps de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. Il n’y a rien d’étonnant dans ce cas qu’il se penche sur la fascination qu’exerce le gouvernement royal français sur l’ensemble de l’Europe, trois décennies après la mort du Roi-Soleil (1715). En 1968, il publie Le despotisme éclairé, chez Fayard.
► Définition d’un paradoxe
Sous ce mystérieux oxymore de « despotisme éclairé » se cache une pratique de gouvernement où le mélange des genres est total. Trois grands axes la sous-tendent.
D’abord, elle est alimentée par la volonté des souverains d’allier une légitimité dynastique avec les idées nouvelles dans l’exercice du pouvoir. En aucun cas, il n’est pas question, dans ce XVIIIe siècle très philosophe, de contester aux grandes maisons qui régissent royaumes et empire depuis la paix de Westphalie (1648) leur souveraineté. Les Habsbourg restent à Vienne et les Bragance à Lisbonne. L’originalité tient plutôt à l’entourage des monarques, lesquels tendent à diminuer l’influence de l’aristocratie au profit de petits nobles ou de bourgeois savants et avancés. Citons pour les plus célèbres, Sébastien-José de Carvalho e Melo (1699-1782), marquis de Pombal au Portugal, ou Johann-Friedrch Struensee (1737-1772) au Danemark.
Ensuite, il faut déceler dans la grande majorité des souverains du XVIIIe siècle des inspirations françaises indéniables. Elles sont de deux natures. Il y a le modèle de Louis XIV, premièrement. Comment pourrait-il en être autrement ? En effet, ce dernier sort la France de la guerre civile, met au pas les parlementaires, réduit la noblesse à un corps de courtisans, et fait beaucoup pour le développement des arts, le tout au bénéfice de sa magnificence. La figure archétypale du roi pacificateur, législateur et mécène fascine et inspire. En second lieu, le français tient le rang de première langue du continent. Elle est la langue du raffinement, l’idiome de l’honnête homme et le vecteur de diffusion des Lumières naissantes sous les plumes de Diderot et Voltaire, lesquels ont leurs habitudes dans les palais de Postdam et Saint-Pétersbourg.
Enfin, la dernière grande caractéristique du despotisme éclairé est le rôle qu’il a occupé dans la marche à la rationalisation de l’État. En ce sens, par ses assises philosophiques, il opère une rupture avec la conception quasi-millénaire que l’Europe a de l’État. Deux siècles après la Réforme, ce sont dans les royaumes catholiques que la mutation est la plus manifeste. La volonté exprimée par Joseph II d’Autriche (1741-1790) ou Joseph Ier du Portugal (1714-1777) de s’émanciper de la tutelle pontificale, par l’expulsion des Jésuites, rejoint les précédents anglicans et luthériens, en Prusse. Cela conduit à ce diagnostic final de Bluche, page 364 (édition de 1983) :
« L’autoritarisme du XVIIIe siècle est assez laïcisé pour se passer de l’Écriture sainte et ignorer Bossuet. […] Avec le despotisme éclairé, l’État s’est fait Dieu. »
► Une figure de proue : Frédéric II le Grand
À plusieurs égards, Frédéric II le Grand (1712-1786) est le façonneur de ce nouvel art de gouverner. Né à Berlin, il hérite en 1740 de l’État le plus imposant de l’espace germanique. La mutation de ce modeste électorat de Brandebourg en royaume conquérant ne dure pas plus d’un siècle. Celui que Bluche brosse sous les traits d’un prince éclairé et musicien n’en demeure pas moins un Hohenzollern.
Outre le Brandebourg et le Magdebourg, le royaume de Prusse se prolonge à l’est jusqu’à Königsberg, sur les anciens domaines teutoniques, et commence à grignoter, à l’Ouest la vallée de la Rühr. Le primat prussien dans les Allemagnes tient pour beaucoup à son caractère protestant. Il est le seul rival religieux de taille aux territoires héréditaires habsbourgeois, dont le prestige pâlit depuis la guerre de Trente ans.
La rupture qu’amène le règne de Frédéric II dans les pratiques de gouvernement est à chercher dans sa philosophie du pouvoir. De ce fait, en sus de sa légitimité comme héritier de solides souverains ayant fait la Prusse, il introduit théoriquement la notion d’un contrat, chère à John Locke (1632-1704) et Jean-Jacques Rousseau (1712-1774), liant le monarque à ses peuples. Sur ce point, il assimile les préceptes rationalistes d’intellectuels germaniques du siècle — en premier lieu Christian Wolf (1679-1754) — regroupés sous le terme générique d’Aufklärung, « l’Eclaircissement ».
La fidélité à cet accord se double d’une marque de tolérance dont la foi protestante semble encourager. Après la révocation de l’Édit de Nantes (1685), le Brandebourg accueille les huguenots persécutés. En 1773, c’est en Prusse que l’ordre de Jésuites survit, alors qu’il est dissout dans les royaumes catholiques. Il faut noter chez Frédéric un goût prononcé pour les arts de toutes sortes. Francophile, il copie Versailles pour créer le château du Sans-Souci, à Potsdam, et s’entoure de ses philosophes. En parallèle de libertés accordées aux différents cultes et à la presse, il favorise l’implantation de près de cent mille colons, qui constituent la force militaire de la Prusse.
En effet, sous ses apparats et les fréquentations du roi, ce dernier demeure un souverain absolu imprégné de raison d’État. Celle-ci s’exprime par les guerres faites à l’archiduché d’Autriche (guerre de Succession d’Autriche) puis à la France (guerre de Sept ans). Pour garantir la sécurité du royaume, Frédéric conquiert la Silésie, et démembre la Pologne. Mort sans enfant, il laisse ce royaume en de mauvaises main (celles de Frédéric-Guillaume II) mais, comme un joueur de flûte, comme le rappelle l’auteur en page 93 :
« Il sert de guide, jusqu’à la Révolution française, à la foule consciente ou inconsciente des souverains et des hommes politiques de l’Europe des Lumières. »
► Réalités disparates du despotisme éclairé
Pour traiter des formes diverses qu’a pris le despotisme éclairé, Bluche procède par blocs géographiques. Et force est de dire que le pli est bon. Quelques lignes suffisent à illustrer le choix judicieux de l’auteur.
 Après la Prusse, place à l’Empire couplé à l’Autriche dans son centre de gravité commun, Vienne. Hommage est rendu d’abord à l’œuvre de Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780) qui est toujours vivante lorsque son fils, Joseph de Lorraine (1741-1790 est couronné empereur. Il prend alors le nom de Joseph II.
Après la Prusse, place à l’Empire couplé à l’Autriche dans son centre de gravité commun, Vienne. Hommage est rendu d’abord à l’œuvre de Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780) qui est toujours vivante lorsque son fils, Joseph de Lorraine (1741-1790 est couronné empereur. Il prend alors le nom de Joseph II.
Son idée fixe est de répondre aux questions identitaires de l’Empire. Centralisatrice et prometteuse de l’allemand au rang de langue officielle, elle doit néanmoins composer avec les Hongrois (1741). La tâche est reprise par Joseph, « dont ni Philippe II, ni Louis XIV, ni Charles III d’Espagne n’ont surpassé [ce monarque] en travail personnel » d’après l’auteur, en page 121, secondé par Wenceslas von Kaunitz (1711-1794).
L’empereur imprime une vision pré-jacobine à ses États : fonction publique germanophone aux quatre coins de l’Empire, suppression des barrières douanières et par là, des droits ancestraux de chaque royaume, les Diètes locales ne se réunissant plus que par le bon vouloir de l’Empereur.
En matière religieuse, le joséphisme est instauré. Ce gallicanisme à la viennoise fait de Kaunitz un véritable « Nogaret autrichien ». En 1782, lors d’un séjour du pape Pie VI à Vienne, Kaunitz aurait sévèrement rabroué le souverain pontife. Les questions soulevées lors de la querelles des Investitures réapparaissent, et le chancelier exprime avec clarté sa vision gibeline et utilitariste du catholicisme : « La religion est même soumise à la surveillance du prince quant à sa doctrine et sa morale. » En somme, la religion doit servir à balayer les anciennes superstitions locales, à contrecarrer le déisme et l’athéisme, mais ne saurait contester la primauté de l’État sur l’Église.
Logiquement, Bluche consacre un chapitre au règne de Catherine II de Russie (1729-1796), impératrice de 1762 à 1796. Dans l’Empire des Romanov, la contradiction est la plus manifeste. En dépit du claquant des palais de Saint-Pétersbourg et de la publication du Nakaz, code de lois inspirées par les écrits de l’amie de Catherine II, le baron de Montesquieu (1689-1755), les bonnes initiatives achoppent sur la résistance de la noblesse féodale et des cosaques.
Malgré ces freins, une prospérité économique s’amorce, et la Russie devient une importante actrice du théâtre européen. Après s’être assuré le contrôle par la Crimée de la mer Noire, l’impératrice place sur le trône de Pologne son ancien favori, Stanislas Poniatowski (1732-1798), avant de bénéficier du partage de celle-ci. Sur le modèle viennois, Catherine divise son royaume en cinquante gouvernements, facilitant le contrôle des territoires les plus périphériques. Bluche conclue en demi-teinte sur l’œuvre de cette dernière, page 210 du livre :
« Catherine II, faute d’un développement suffisant des classes moyennes, utilise pour créer un État moderne et une industrie capable de progrès, des méthodes qui font régresser son empire, retardent pour un siècle l’évolution de la société russe, « orientalisant » un pays dont elle a pourtant proclamé, à la suite de Pierre le Grand, la vocation européenne. »
Suit l’espace méditerranéen, où règnent majoritairement de faibles Bourbons, cadets de ceux qui trônent à Versailles. La noblesse y est pour grande partie peu perméables à la nouvelle philosophie. On décèle quelques ministres éclairés palliant à la mollesse royale : Guillaume du Tllot (1711-1774) à Parme, Pompeo Neri puis Francesco Gianni à Florence. La conception traditionnelle de l’autorité n’est nullement remise en question pas plus que la soumission au Saint-Siège, à l’exception notoire du Portugal assujetti à Pombal.
Enfin, le Nord de l’Europe est brièvement abordé. Ces monarchies protestantes souffrent également de la faiblesse de leur monarques, et voient l’émergence de parvenues à la tête de l’État. Le roi du Danemark, Christian VII (1749-1808), faible et dément, est aussi un mari trompé par son principal ministre : Struensee. Gustave III de Suède (1746-1792), élevé à la française, soumet les quatre ordres suédois par un coup d’État lors de son avènement en 1771, digne de celui de René-Nicolas Maupeou (1714-1792) qui arraisonne le Parlement de Paris la même année.
► L’exception française
Le despotisme éclairé naît d’une fascination qu’opère Louis XIV à une grande partie des souverains du XVIIIe siècle. Le fait singulier est qu’il ne soit pas appliqué dans le gouvernement du royaume de France. À aucun moment, on ne saurait appliquer à Louis XV le sobriquet de « despote éclairé ». C’est qu’il eut été impossible d’imposer une quelconque forme de contrat sans faire tomber la monarchie. Car si le royaume est dépourvu de constitution écrite, des maximes et des coutumes limitent l’exercice de l’autorité royale en France.
En particulier, fidélité à l’Église, respect de la procédure d’enregistrement des Parlements et garantie des libertés provinciales, sont formulés lors du sacre, et engagent le roi à s’y tenir. Comme Bluche le rappelle en lettres capitales dans son Louis XIV, reprenant sa citation en page 190 dans Le despotisme éclairé : « Si les juristes anciens ont passé beaucoup de temps à énumérer et à préciser les droits du Roi, c’est parce que le Roi n’a pas tous les droits. »
Difficile dit-il encore, dans Le despotisme éclairé, « de dénigrer le gouvernement personnel de Louis XIV, de nommer « absolutisme » sa monarchie administrative ». L’auteur fait en effet valoir que ce régime se prévaut d’« une philosophie équilibrée, humaniste et chrétienne« .
► Le bilan mitigé des despotismes éclairés
À la veille de la Révolution française, de quoi accouchent tous ces gouvernements éclairés à travers l’Europe ? C’est cette question qui occupe l’entièreté de la conclusion de Bluche. Le mariage entre princes et philosophes périclite, pour ainsi dire. Diderot voit son rêve de « République des Lettres » s’effondrer devant le pragmatisme froid des princes, et Voltaire se brouille avec Frédéric.
On ne constate pas de meilleures réussites sur les mutations sociales que les monarques enclenchent. Les disparités demeurent et les souverains initiateurs disparaissent. Néanmoins, certains ont tant imprimé à leur principauté une religion de l’État dont la Prusse et la Russie sont ici des modèles. On a désincarné le souverain de l’État, d’où le mot final de l’auteur : « C’est Louis XIV sans perruque. »
Le despotisme éclairé disparaît avec la Révolution française et jusqu’en 1815, une phase de réaction s’observe dans la plupart des États européens, protestants comme catholiques. En dépit de cette inflexion, l’État personnifié et post-jacobin a raison des trônes tout au long du XIXe siècle.
— Benjamin RATICHAUX

