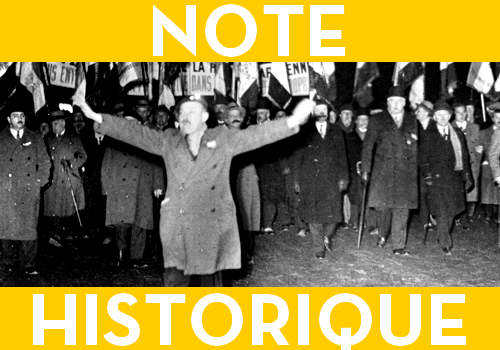
À la suite de notre émission Date-clef, retrouvez dès à présent notre note historique sur les émeutes antiparlementaires du 6-Février. Ces événements sont la conséquence de l’instabilité parlementaire chronique de la Troisième République française.
► Le contexte d’une république fragilisée
« Paris et sa banlieue ont toujours été des terres de très forte implantation pour les nationalistes. », rappelle Albert Kéchichian dans un livre de 2006, Les Croix de feu à l’âge des fascismes. Travail, Famille, Patrie. Il explique ainsi la typicité parisienne et francilienne du nationalisme français à cette époque, bien peu compréhensible aujourd’hui. Mais il est vrai que les ligues de l’entre-deux guerres, à la droite de la droite et pas seulement, royalistes de raison ou promotrices d’un nouvel ordre républicain, par la réforme de l’État, rétives voire hostiles à la démocratie parlementaire, ont pour elles la peur, réelle ou feinte, du communisme international, d’une « soviétisation » de la France, et en face d’elles la réalité objective de la Ceinture rouge, ce collier de municipalités PCF, qui, croient-elles, enserrent, compriment Paris ; avec la capitale, le Pays réel.
Nous sommes le 6 février 1934, et, en France — pas seulement dans la capitale — la Troisième République paraît aller bien mal. L’affaire Stavisky, du nom de cet escroc étranger et suicidé un mois plus tôt, Alexandre Stavisky, est naturellement le facteur bien connu aboutissant finalement à l’émeute.
Avec cette étrange disparition, semble compromise une grande partie de la classe politique, à commencer par la majorité parlementaire. Mais le « 6-Février » ne se résume pas qu’au destin de Sativsky, occasionnant, ricochet de l’Histoire, les charges de la Garde républicaine contre de jeunes camelots royalistes, place de la Concorde, la quinzaine de morts immédiats, des pavés descellés, une marche plus ou moins aboutie vers le Palais Bourbon, et, au milieu de cet océan des droites, comme perdus, les communistes de l’ARAC.
Au fond, le 6-Février symbolise l’entre-deux guerres à lui seul. Il incarne cette « montée des périls » — terme historiographique consacré, quoique réducteur — que l’on constate depuis l’automne 1922 et la Marche sur Rome de l’ancien socialiste Benito Mussolini, théoricien du fascisme. Cette montée culmine avec la Débâcle de juin 1940.
Entre ces deux dates, le 6-Février figure à une intéressante équidistance, moment auquel, en France, la vie politique s’inspire ou réagit à ce qui se passe en Italie, en Union soviétique et en Allemagne. On le verra tant par exemple du côté des communistes que des Croix de feu. Revenons d’ailleurs sur ce groupe, l’une des ligues emblématiques de la crise du 6-Février.
► Les Croix de feu, mouvement d’anciens combattants
La composition sociologique des Croix de feu durant les années précédant la crise du 6-Février nous renseigne amplement sur le public des futures émeutes parisiennes. Outre ce qui a été soulevé en introduction, relativement au primat francilien du recrutement, par rapport à la province (de l’ordre de 65 % contre 35 % en 1931, alors que la province représente alors 14 % de la population nationale), l’on constate assez logiquement dans ce mouvement encore en développement, ni vraiment politique au sens électoral, une surreprésentation d’une minorité de classes.
Ainsi, d’après les données compilées à partir des relevées à partir des relevés publiés dans L’Ami du peuple, puis Le Flambeau, entre mai 1928 et décembre 1929, l’on peut remarquer que l’aristocratie et la haute bourgeoisie, de même qu’une bourgeoisie plus moyenne, sont très représentées : respectivement 10 % et 22 % du total des adhérents, quand ces deux « blocs » recouvrent en réalité 5 % de la population française, une minorité.
In fine, les Croix de feu recrutent initialement au sein des milieux sociaux ayant le plus à craindre d’une possible révolution du prolétariat à la soviétique : c’est-à-dire les cadres et chefs d’entreprises, propriétaires terriens, professions libérales, rentiers. Le groupe majoritaire en leur sein concentre les classes moyennes (50 % des adhérents, contre 30 % de la population), cependant que celles-ci sont en réalité comprises selon une acception limitée du terme. Ainsi, le recrutement se réalise avant tout dans les classes moyennes indépendantes que constituent les commerçants et les artisans. En réalité, les nouvelles classes moyennes de fonctionnaires, d’employés et, au sommet, de techniciens, donnent moins d’hommes aux Croix de feu.
Le métier qui recrute le plus pour les Croix de feu est clairement celui d’assureur. Inversement, les paysans sont quasiment absents (1,9 % des adhérents, pour 34 % de la population), ce qui s’explique d’abord par leur mobilisation dans les usines d’armement durant la Première guerre mondiale, au titre des affectés spéciaux, pour environ 7,5 % d’entre eux, loin du théâtre de guerre, et donc des médailles. Mais cette quasi-absence du monde agricole dans les effectifs des Croix de feu a surtout une explication plus prosaïquement sociologique, de l’ordre du ressenti de classe : comme le rappelle Kéchichian, les paysans « n’entrent pas encore dans les réseaux de sociabilité des agents recruteurs, ceux d’une bourgeoisie urbaine très clairement politisée ».
Pour autant, l’examen des différentes ligues de l’entre-deux guerres, et des groupes qui en constituent les prodromes, n’accrédite par l’idée générale d’un recrutement unanimement effectué parmi les classes aisées. Par exemple, comparativement, les deux principales organisations françaises d’anciens combattants que représentent alors l’Union nationale des combattants (UNC) et l’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants (UF), cumulant huit cents mille membres, sont bien plus représentatives des différents groupes sociaux, somme le fait savoir Antoine Prost dans le deuxième tome de l’Histoire militaire de la France.
En fait, le recrutement aisé des Croix de feu fait surtout penser à celui de l’Action française, de Charles Maurras. Les trois mille trois cents membres initiaux des Croix de feu agrègent ainsi dans les rangs différentes figures de la haute société : les princes d’Altoro Colonno de Stigliano et de Faucigny-Lucinge, les comtes Boissy d’Anglas, la Rocque de Séverac — futur chef, à partir de 1931 — et de Villèle, les marquis de Beauregard, de Dreux-Brézé, d’Ortefeuille, de Terrier-Santons, le duc Pozzo di Borgo, l’aviateur Dieudonné Costes, l’auditeur au Conseil d’État René Giscard d’Estaing, Matthieu de Lesseps, etc.
L’on observe donc un rapport très varié entre groupes nationalistes et classes populaires. Un élément tend cependant à figer l’intérêt de chaque groupe pour le prolétariat : ce grand brassage des classes sociales que, rétrospectivement, constituent les tranchées de la Grande guerre.
► L’égalité devant la mort, ou la découverte des milieux populaires
Pour une ligue comme les Croix de feu, l’égalité devant la mort est l’occasion d’une découverte des milieux populaires. Cet élargissement des horizons sociologiques renforce évidemment le sentiment d’un destin national commun, par le mélange des classes dans l’épreuve.
De retour dans le champ civil, cette unité de classes des tranchées — finalement semblable à l’Union sacrée du monde parlementaire — est remise à l’honneur. Ainsi, les Croix de feu apportent par exemple leur secours à des compagnons chômeurs, comme à Vitry-sur-Seine ou à Sarcelles, avec la création d’un service d’entraide et la demande aux adhérents « d’indiquer tous les emplois vacants de leur corporation dont ils auraient connaissance ».
Naturellement, François de La Rocque de Séverac lui-même donne l’exemple dans sa parole publique. Dans Le Flambeau, organe mensuel des Croix de feu, il déclare, en janvier 1931, mêlant interclassisme et refus du clivage droite-gauche :
 « Aux Croix de feu, il n’y a pas de classes, il n’y a que des camarades, de l’Avant, le plus riche tend la main au plus pauvre, il n’y a pas de classification politique, le militant d’Action française peut y rencontrer le plus farouche SFIO, sous condition de laisser au vestiaire de l’association son programme politique. »
« Aux Croix de feu, il n’y a pas de classes, il n’y a que des camarades, de l’Avant, le plus riche tend la main au plus pauvre, il n’y a pas de classification politique, le militant d’Action française peut y rencontrer le plus farouche SFIO, sous condition de laisser au vestiaire de l’association son programme politique. »
Cette conception interclassiste et rassembleuse de La Rocque de Séverac, préfigurant quelque peu le RPF gaulliste, mais moins en revanche les populismes de la fin du XXe siècle, en préférant la référence au sacrifice ascétique du commandement militaire transposé au monde civil, à des facilités de langage « attrape-tout ». La Rocque assume publiquement tenir cette conception des choses des grandes figures françaises du catholicisme social : Le Play, La Tour du Pin, et surtout Lyautey. Nous tenons cet « aveu » de déclarations de 1942, époque à laquelle celui qui préside le Parti social français, naturellement en sommeil pour double motif de guerre et de refus de collaborer — contrairement au Parti populaire français de Jacques Doriot — est alors admis à siéger au Conseil national de l’État français, chambre consultative et corporative de l’autorité de Vichy. C’est bien la preuve du traditionalisme du colonel.
Il faut revenir en particulier sur La Rocque et Lyautey. La proximité entre les deux n’est pas qu’idéologique. Elle s’explique aussi par la propre carrière militaire du colonel, avec l’exercice de divers commandements au Maroc, alors protectorat français, entre 1913 et 1926.
Vingt années plus tard, retraité de l’Armée, et à la tête d’un mouvement d’anciens combattants dynamique, La Rocque s’apprête à faire marcher ses Croix de feu place de la Concorde, aux côtés de groupes aussi divers que les Francistes, l’Association républicaine des anciens combattants (ARAC), Solidarité française, les Jeunesses patriotes, la Fédération des contribuables et l’Action française.
Encore faut-il nuancer la bonne tenue de cette marche : tous les groupes ne sont pas aussi volontaires dans l’idée de renverser la Chambre et le Sénat. De cette improvisation des droites comme de ces appréciations diverses de la situation, sort un assaut finalement manqué contre le régime.
► Les préparatifs du 6-Février
Le 3 février 1934, l’on apprend que le préfet de Police de Paris, Jean Chiappe, est muté au Maroc. De cette façon, Édouard Daladier, président du Conseil nouvellement nommé, applique une série de mutations et de sanctions pour éloigner les hommes éclaboussés par l’affaire Stavisky. Or, Chiappe est apprécié de la droite et des ligues, auxquelles il montre son indulgence lors de leurs manifestations.
À gauche, la presse accuse Chiappe depuis plusieurs semaines d’être impliqué dans l’affaire Stavisky. Mais la droite dénonce le résultat d’un marchandage avec les députés socialistes : le départ de Chiappe contre un soutien au nouveau gouvernement. Le bruit court de plus que le général Weygand, en conflit avec le président du Conseil, sera le prochain sur la liste des mutations.
► Un assaut raté contre la République
L’Histoire retient que l’assaut des ligues contre la République, au soir du 6 février 1934, est un échec. Il importe de rappeler que les manifestants ne sont au final pas si unis, défilant en cortèges distincts, et en vue de motivations divergentes.
Première de ces divergences, la question du régime « d’après » n’est tout de même pas anodine. Antiparlementaire et royaliste, l’Action française veut logiquement un renversement du Parlement, de même qu’une restauration monarchique. Inversement, les Croix de feu, tenants d’un républicanisme issu du Ralliement et partisans d’un régime présidentiel, ne veulent pas tout bousculer.
Ce hiatus ne peut que conforter les mésestimes préexistant entre ces deux groupes. Ainsi, l’AF perçoit La Rocque et ses hommes comme des couards, des « froides queues ».
En réalité, dans cette affaire, le colonel fait montre de discernement. À cette même époque, il éconduit Noël Pinelli et d’autres conseillers de Paris souhaitant la mise en place d’une coalition nationaliste. Il refuse de même de rallier l’hypothétique « gouvernement de Salut public » que le radical-socialiste Eugène Frot lui propose, voulant associer droite et gauche. Au demeurant, ces refus de l’aventure, n’est pas que guidé par la raison. Il tient aussi au caractère rigide de La Rocque, un intraitable souci d’indépendance qu’il conserve par la suite en 1937 face à Doriot et sa perspective d’un « Front des libertés » face au Front populaire. La Rocque a alors certes davantage les moyens politiques de cette indépendance, puisque son PSF caracole en vue du million d’adhérents.
Pour l’heure, son attentisme du 6-Février passe pour de la traîtrise, non de la hauteur, dans les rangs de l’AF. On lui impute grandement la quinzaine de morts immédiats de la soirée d’émeutes, l’absence d’armement réel, et le désordre des cortèges (place de la Concorde, pont de Solférino…). Furieux, Maurice Pujo écrit ainsi le 18 novembre 1935, dans les colonnes de L’Action française :
« Quand on prend tant de précautions publiques pour ne pas être en contact avec les révolutionnaires quand on se vante d’avoir fait changer de chemin à ses hommes pour éviter de les rencontrer, quand on cache l’heure et le lieu des réunions sous prétexte de ne pas les « provoquer », […] quand on se conduit ainsi, on donne tout naturellement aux gens du « Front populaire » l’idée que, quel que soit votre nombre, ils vous font peur, et qu’ils peuvent vous attaquer. […] Mais commencer l’action pour ne jamais agir ; rassembler les bonnes gens pour les écarter de la lutte quotidienne, c’est tout ce qu’il faut pour coaliser les adversaires, en leur enlevant toute crainte, pour créer de ses propres mains la force adverse et l’encourager ; c’est attirer les coups et servir de plastron. »
Joseph Pozzo di Borgo, dans le procès qui l’oppose à La Rocque, ne dit pas autre chose. Durant son audience du 29 novembre 1937, il déclare ainsi :
« Vous nous avez parlé d’heure H, et vous nous avez embarqués, vous nous avez excités. Et lorsque l’on vous parlait de question d’armes, vous preniez un petit air modeste, en disant : « Ne vous préoccupez pas de cela, et d’ailleurs […] j’ai beaucoup d’accointances dans l’armée, tout cela s’arrangera !« »
Paradoxalement, pour sa défense, La Rocque, qualifie lui-même les meneurs du 6-Février de « ligues », de « phalanges de salut public ». Il explicite a posteriori, dans un long plaidoyer pour la légalité républicaine, dans Le Flambeau du 26 octobre 1935 :
« Ni les complications extérieures, ni les menées du marxisme moscoutaire, ni les agissements d’arrivistes factieux du 6-Février ou de leurs émules, ni même les électeurs ne doivent nous laisser inactifs : l’œuvre de progrès social et de réconciliation des classes doit encadrer, orienter, expliquer chacun de nos gestes. Il nous faut figurer une réduction chaque jour agrandie, complétée de ce que devraient être l’État et le pays lui-même dans une France renaissante et régénérée. C’est pour de semblables témoignages que les grandes rénovations s’imposent. Le recours à l’agitation n’y ajoute que des épisodes le plus souvent désagrégateurs et superflus. »
Ces procès en patriotisme, par presse interposée, et ceux, réels, en disent beaucoup des divergences stratégiques entre les différentes ligues nationalistes qui mènent l’assaut contre la République, au soir du 6 février 1934. Ce n’est pas la cohorte unie qu’un jugement rétrospectif et biaisé laisse souvent entrevoir.
BIBLIOGRAPHIE
- BERSTEIN (Serge). Le 6 février 1934. Paris, Gallimard, 1975.
- GALERA (Yann). La Garde républicaine à l’épreuve du 6 février 1934. Maisons-Alfort, Service historique de la Gendarmerie nationale, 2003.
- KÉCHICHIAN (Albert). Les Croix de feu à l’âge des fascismes. Travail, Famille, Patrie. Ceyzérieu, Champ-Vallon, 2006.
- PELLISSIER (Pierre). 6 février 1934, la République en flammes. Paris, Perrin, 2000.
- SOUCY (Robert). Fascismes français ? 1933-1939. Paris, Autrement, 2004.

