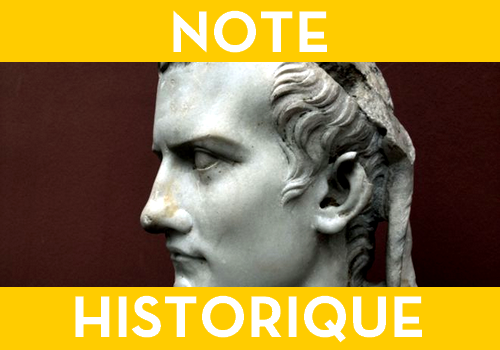
À la suite de notre émission Date-clef, retrouvez dès à présent notre note historique sur l’assassinat de l’empereur Caligula. C’est la première fois qu’un empereur romain connaît une mort violente et précipitée, quelques décennies après l’instauration du Principat.
► Un archétype de l’empereur-tyran
Aux côtés de Néron (37-68), un de ses successeurs, Caligula (12-41) est incontestablement l’archétype de l’empereur-tyran. Cette construction du personnage caligulien est largement due au littérateur romain Suétone (vers 70-124), contemporain des Antonins, dans son De vita duodecim Caesarum (Vie des douze Césars).
Ce ressenti d’une période tyrannique est l’histoire du court règne de Caligula qui, symboliquement, se situe à équidistance entre les deux extrêmes de la dynastie julio-claudienne : l’avènement d’Auguste (27 avant Jésus-Christ) et la déposition de Néron (68 après Jésus-Christ). Cette histoire est, paradoxalement, celle de « deux règnes en un ».
- LIRE AUSSI : L’instauration du Principat augustéen
► Les « deux règnes » de Caligula
À en croire l’historiographie, le règne de Caligula séparerait en deux parties. Initialement perçu comme positif, après la fin de règne morose de Tibère (42 avant Jésus-Christ-37 après Jésus-Christ), l’avènement de Caligula, salué comme une période de faste, renouant avec la grandeur augustéenne, aurait laissé place à une période sombre, d’excès, de tyrannie et de débauche. Quoique le portrait soit sans doute noirci par les littérateurs de l’Antiquité romaine — à l’instar de ce qui sera écrit sur Néron, notamment concernant l’épisode de l’incendie de Rome, en 64 — les historiens s’accordent toutefois factuellement à dire de Caligula que, durant son règne, il est atteint de démence.
Dans L’Empire romain d’Auguste à Domitien (2001, rééd. 2010), Claude Briand-Ponsart et Frédéric Hurlet répètent à l’envi l’existence de ce schéma binaire des deux règnes de l’empereur : « Le principat de Caligula est d’ordinaire divisé en deux moments bien distincts : à un bon début de règne aurait succédé une démesure grandissante et une série d’atrocités« .
► Le « premier règne » de Caligula
Caligula était-il au reste destiné à diriger l’Empire ? Il faut rappeler qu’à l’inverse des monarchies et des empires médiévaux, la succession sous la Rome antique n’est que rarement héréditaire. Elle procède en réalité de mécanismes peu normés, et largement tributaires des rapports de forces politiques entre les gens — grandes familles — du moment, voire d’une certaine violence, qui peut aller jusqu’à l’assassinat. Caligula lui-même, nous le savons, en fera les frais à la fin de son règne. Il est d’ailleurs le premier empereur à être tué (dans une sorte d’imitation du césaricide initial, en 44 avant Jésus-Christ), le premier d’une longue liste.
Succédant à Tibère, donc, en mars 37, Caligula se voit assigné la succession conjointement au petit-fils de l’empereur. Celui-ci, du nom de Tibère Gémellus (16-vers 38), est rapidement éliminé par Caligula lorsqu’il accède au trône.
N’étant pas son fils, ni un parent direct de Tibère, Caligula n’en est pas moins proche de l’empereur depuis 33 environ, époque de la fameuse « retraite de Capri », en mer Tyrrhénienne. Le jeune homme y suit alors l’empereur vieillissant dans curieux exil.
Ces quelques années de proximité entre l’empereur et sa succession trouvent leurs origines de la famille de Caligula. Né en août 12 à Antium, dans le Latium, il est le fils de Germanicus (15 avant-19 après Jésus-Christ), général romain et premier héritier présomptif de Tibère, et d’Aggripa l’Aînée (14 avant-33 après Jésus-Christ). Son nom de « Caligula », qui signifie « Petite sandale », en latin, témoigne d’une jeunesse passée dans l’univers militaire de son père, en pleine tentative de conquête de la Germanie.
Son « premier règne » de Caligula commence donc plutôt positivement, selon les historiens antiques. Arrivé à Rome vers le 25 mars 37, le nouvel empereur reçoit un bon accueil, tant de l’aristocratie que de la plèbe. Habilement, il insiste sur sa filiation, en faisant un des arrière-petits-fils d’Auguste (63 avant Jésus-Christ-14 après Jésus-Christ), l’empereur des origines.
En avril, Caligula embarque pour les îles de Pandateria et de Pontia, où sa mère et son frère Néron César, avaient été relégués par Tibère, et étaient morts. Pour le symbole, Caligula ramène leurs cendres à Rome, et les dispose dans le mausolée d’Auguste, aux côtés de celles de Drusus, son autre frère.
Le rapport de Caligula par rapport à son prédécesseur Tibère semble plus ambigu. Ainsi, le 3, malgré l’éloge funèbre qu’il prononce, comme il est d’usage, il se refuse à prononcer sa divinisation. Ce refus est complété de critiques contre l’ancien empereur, dans un discours que fait Caligula le 1er juillet. Il y insiste notamment sur sa volonté de travailler aux côtés du sénat, et non contre lui. De ce changement d’optique par rapport à Tibère, naît une partie de ce jugement positif sur le « premier règne » de Caligula.
Mais cette politique de conciliation ne dure pas. Le règne de Caligula prend un tournant vers décembre, comme nous le disions, lorsque l’empereur décide l’assassinat de son cousin et fils adoptif Gémellus. Cette mise à mort brutale est d’autant plus mal perçue que Gémellus est à la fois sénateurs et, surtout, l’un des cohéritiers de Tibère. Caligula l’écarte pour ne pas s’encombrer d’un rival.
► Le « second règne » de Caligula
Progressivement, l’empereur bifurque vers ce qui semble être un « second règne », dont Briand-Ponsart et Hurlet nous indiquent qu’il est celui d’un « prince qui réunit très vite les traits moraux propres au tyran dans la tradition antique« , à savoir la luxure, la cruauté, la cupidité, la jalousie.
En fait, le portrait de Caligula comme tyran illustre les tensions croissantes entre l’empereur et le sénat. Au-delà de l’assassinat de Gémellus, l’empereur faute sur le plan religieux, en divinisant pour la première fois une femme — sa sœur, Drusilla — et en assimilant le pouvoir impérial à Jupiter et Hercule.
Sa politique dépensière vise à s’attirer les faveurs de la plèbe. Caligula délaisse symboliquement la toge pour des tuniques florales. On le soupçonne alors d’orientalisme, dans le sillage d’un Marc Antoine (83-30 avant Jésus-Christ). Ces attitudes fantasques et son autorité brutale ne peuvent qu’attiser les conflits, et, bientôt, les conjurations.
► Caligula assassiné
L’assassinat de Caligula est précédé de conjurations manquées, à l’initiative de ses sœurs, Agrippine la Jeune et Julia Livilla, ainsi que son favori, Marc-Émile Lépide. Un dernier complot, en janvier 41, a raison de l’empereur. Caligula est alors assassiné par les soldats de sa garde personnelle. Dans la foulée, les prétoriens proclamant empereur Claude (10 avant Jésus-Christ-54 avant Jésus-Christ), que la légende dit caché derrière un rideau.
 Les conspirateurs sont principalement Chérée, Émile-Régulus, Cornélius Sabin, Vinutien et Aquila. Ces personnages sont peu connus. Des sénateurs semblent également mêlés. L’épisode est raconté dans le détail par le littérateur Flavius Josèphe (vers 37-100).
Les conspirateurs sont principalement Chérée, Émile-Régulus, Cornélius Sabin, Vinutien et Aquila. Ces personnages sont peu connus. Des sénateurs semblent également mêlés. L’épisode est raconté dans le détail par le littérateur Flavius Josèphe (vers 37-100).
► Le système politique romain, monde violent
L’assassinat d’un empereur, pour spectaculaire qu’il soit, n’est pas quelque chose d’impensable sous la Rome antique. L’Antiquité romaine se caractérise par sa violence politique, et l’historiographie antique ne dément pas cette réalité. Symboliquement, en France, l’agrégation externe d’histoire portait ainsi en 2016 sur le thème « La violence politique dans le monde romain« , comme sujet de dissertation.
Malgré tout, le monde romain voit émerger un certain ordre des choses, pour limiter ces violences : Sénat, magistratures… Le système politique romain, républicain comme impérial, s’il vient à ce titre juguler la violence politique, par l’ordre, l’encourage dans le même temps par les élection, l’expansion territoriale, le partage des provinces et celui du pouvoir en général.
Comment la vie politique romaine se singularise-t-elle par sa violence, vis-à-vis de ses précédents politiques, comme par exemple la vie politique dans les cités du monde grec ? Cette violence répond-t-elle à un besoin pour consolider l’assise du régime ? Il importe de bien contextualiser cette violence par rapport à l’époque, et à la violence « classique » des systèmes impériaux.
La violence politique dans le monde romain prend diverses formes. Elle s’exerce par les proscriptions, les conjurations, les assassinats, les usurpations, les condamnations judiciaires et des formes plus symboliques (calomnies, damnation de la mémoire…). Ces expressions de violence politique survivent d’ailleurs à l’instauration du Principat augustéen, aux premières années de l’ère chrétienne, car, manifestement, le principe d’un chef unique, l’empereur, s’imposant aux factions ne tarit pas les ambitions individuelles.
On envisage d’ailleurs mal qu’un système politique voulant étendre son emprises depuis Rome jusqu’à la plus grande partie du « monde connu » de l’époque puisse le faire sans violence. La puissance romaine n’est jamais qu’impérialiste, logiquement. Dans sa définition même, l’empire est violent et défensif. Il n’a pas de frontières, dans la mesure où il dispose d’un limes, qu’il défend militairement contre ses assaillants éventuelles, barbares (barbaroi), c’est-à-dire, « autres ». Il n’y a pas de frontières fixes de l’Empire romain. Il n’existe qu’un limes mouvant, lequel marque une ligne de violence entre ce que Rome a et n’a pas pas encore conquis.
Cette violence aux marges de l’Empire est connue de ceux, promagistrats et légats impériaux, qui gouvernent les provinces. Ceux qui, dans leurs vies publiques, occupent également des fonctions politiques, sont donc accoutumés à la violence. Mais si la violence politique revêt des formes plus symboliques que celle des campagne militaires, elle reste réelle, et contraste avec l’idée générale d’un monde romain progressivement unifié par son empire, son droit et ses institutions.
En ses origines, la violence politique dans le monde romain procède de la recherche, pendant longtemps, d’hommes forts sinon providentiels pour incarner le pouvoir, au sein d’une société qui, traditionnellement, rejette dans le même temps la monarchie, pouvoir d’un seul (mono arkè, en grec). En effet, les Romains avaient su destituer la royauté en 509 avant Jésus-Christ, détrônant la dynastie des Tarquinides, pour instaurer une république, parce que redoutant l’aspect arbitraire caractérisant parfois le pouvoir royal. Il en est résulté que, toujours, les dirigeants de la République romaine eurent à cœur de prouver au peuple qu’ils rejetaient l’aspiration à la monarchie, même en cas de grande popularité personnelle. C’est ainsi que, en 44 avant Jésus-Christ, l’on voit Jules César refuser le diadème royal qui lui est proposé, alors que celui-ci est au faîte de sa puissance, après la conquête des Gaules et sa victoire sur Pompée le Grand.
- LIRE AUSSI : La fin du siège d’Alésia
César, alliant qualités politiques et militaires, est alors un imperator. Il fallait bientôt qu’émerge ce type de réponse intermédiaire entre le refus d’une restauration monarchique et un régime strictement « sénatorial », alors que la République étendait ses conquêtes dans l’actuelle Europe et en Afrique du Nord, les différentes provinces (provincia). L’oeuvre de conquête devenant importante, les imperatores répondaient au besoin populaire d’un pouvoir incarné avec autorité et dans la durée, non plus l’alternance complexe des magistratures (consulats annuels, censures d’une année et tous les cinq ans…).
Avant César, d’autres figures importantes de la vie publique romaine, toutes versées par ailleurs dans de brillantes carrières militaires, exercent la charge — informelle — d’imperator. Ces « pré-empereurs » qui augurent de la concentration à venir des pouvoirs en une seule personne à partir d’Auguste, comprennent Pompée, César, Cinna, Sylla, Marius, qui imposent tous une marque durable à Rome (tel Marius, par sa réforme militaire, dite « marianiste », en son nom). Tous, pour autant, ne sont pas du même « monde », et si le terme de « parti » est impropre pour désigner les factions rivales au sein du Sénat, il faut distinguer le camp des populares de celui des optimates, témoignant d’intérêts divergents servis par les imperatores, entre ceux des élites et du peuple. Si elle instaure un semblant de stabilité, avec l’alternance de magistrats aux prérogatives extraordinaires (telle la dictature, accordée à César) régulièrement prorogés par le Sénat romain, cette succession des différents imperatores finit en réalité de manière prévisible par l’assassinat de César, en mars 44 avant Jésus-Christ, et une période de guerre civile.
L’émergence de nouveaux hommes forts, les imperatores, n’ayant pas empêché les guerres civiles entre factions, le Principat augustéen succédant à la crise politique entre Marc Antoine et Octavien — fils adoptif de César — et la victoire de ce dernier à Actium, en 31 avant Jésus-Christ, règle cette question. Octavien est alors fait empereur, sous le nom d’Auguste. Le nouveau régime institue une stabilité, une continuité des institutions et des hommes, ce, pendant plusieurs décennies.
César, pris au piège des factions, avait finalement fait l’objet de leur violence politique au lieu de les apaiser par sa prééminence impératoriale. Auguste sait pour sa part les tenir en lisière de la vie politique, restreignant les prérogatives du Sénat et concentrant de manière inédite en sa propre personne l’ensemble des pouvoirs (militaires, judiciaires, législatifs, religieux).
Ce processus n’est pas immédiat, car Auguste ne recueille pas dès son avènement l’ensemble de ces pouvoirs, de son imperium futur (tribunitien et judiciaire). Longtemps confié à Lépide (89-12 avant Jésus-Christ), avec qui il forme initialement un triumvirat, aux côtés d’Antoine, avant de l’affronter, le pouvoir religieux lui échappe. Il ne l’obtient qu’à la mort de Lépide, cumulant avec ses fonctions préexistantes celle de grand pontife (pontifex maximus). Préalablement mis à l’écart, Lépide montre par son exemple que la transition entre république et empire, même si elle permet une pacification des rapports politiques, n’empêche pas une violence politique au sein des institutions, même si plus discrète que par le passé.
Sous le Principat, ces violences continuent dans leurs diverses formes d’origine, même si les violences de rues liées aux luttes d’influence entre populares et optimates n’existent plus vraiment. La violence politique se déplace à l’intérieur des lieux de pouvoir et des institutions, autour de deux déclinaisons majeures : les violences physiques et les condamnations morales. Si les proscriptions (comme celle d’Octavien contre Cicéron, en 43 avant Jésus-Christ) disparaissent de manière générale, le pouvoir se débarrasse encore de ses adversaires par l’assassinat, de manière plus discrète que les anciennes listes de proscriptions, publiques. Ainsi, Auguste fait assassiner Agrippa le Posthume, son propre petit-fils.
L’ensemble de ces manifestations spectaculaires de violence politique montrent au peuple romain que, si au titre de ses vertus cardinales, l’empereur sait faire montre de clementia (clémence), il marque aussi par la condamnation à mort de ses ennemis qu’il est le seul chef. La violence politique n’épargne toutefois pas la figure de l’empereur, comme en témoigne le sujet qui nous concerne, et l’élimination de Caligula par les prétoriens.
Mais, dans le monde romain, la violence politique est plus large, couvrant aussi le champ des condamnations, judiciaires comme morales. Le cas de Catilina (108-62 avant Jésus-Christ), échouant dans sa tentative d’accession au consulat, est connu. Cicéron (106-43 avant Jésus-Christ) l’évoque dans ses In Catilinam (Catilinaires), donnant à cet échec politique une dimension littéraire qui détruit la carrière de Catilina, et glorifie Cicéron pour ses talents oratoires et sa maîtrise du débat. Les formes de condamnation par le pouvoir sont aussi plus ordinaires, dans le cadre de la loi. Les cas de gouverneurs corrompus sont ainsi réguliers. En ce cas, il est possible des les relever de leur imperium, à l’instar de Verrès (vers 117-43 avant Jésus-Christ), gouverneur de Sicile. Cela ménage à peu de frais des rapports assainis entre Rome et ses différentes provinces.

La violence politique passe également par des formes plus diffuses de condamnations par le pouvoir, par lesquelles celui-ci s’assure de sa supériorité par rapport à ses adversaires. Ainsi, en préalable à la confrontation d’Actium, Octavien veille par exemple à présenter son adversaire Antoine, auquel il dispute le pouvoir depuis le mort de César, comme un « homme de l’Orient ». C’est cette même accusation d’orientalisme qui, nous l’avions vu précédemment, sera reprise quelques décennies plus tard contre Caligula. Cette forme de condamnation informelle d’Antoine par Octavien, notamment du fait de la liaison de ce dernier avec la reine d’Egypte, Cléopâtre VII Philopator, est une violence politique qui s’attache à faire propagande contre les adversaires du régime.
Il peut également y avoir un aspect posthume dans ces violences. C’est le cas de la damnatio memoriae (damnation de la mémoire), par laquelle le Sénat damne la mémoire d’un empereur condamné pour un règne jugé mauvais. Caligula, paradoxalement, n’a pas à la subir, Claude s’y opposant personnellement.
► Conclusion
L’ensemble de ces violences politiques — physiques comme morales — dessinent le tableau d’un ordre politique certes stabilisé sur ses bases institutionnelles et l’incarnation de ses principes dans le cadre d’un absolutisme impérial, mais qui reste exposé à la fois à la nécessaire violence de l’empereur comme garante de son autorité, et la violence de rejet — conjurations, usurpations — que celui-ci peut éventuellement nourrir parmi ses rivaux les plus enhardis. Caligula en est l’exemple.
On le voit, la violence politique dans le monde romain est endémique, plurielle dans ses formes. Sans doute plus vive sous la République et l’enchaînement des guerres civiles du Ier siècle avant Jésus-Christ, elle change surtout de lieux — jusqu’à l’intérieur des lieux de pouvoir — sans changer en intensité sous l’Empire. Si celui-ci la jugule en partie, il ne peut empêcher que ce nouveau pouvoir fort étant parfois contesté, il suscite en retour la violence politique de ceux qui veulent y prendre part. Ainsi n’y a-t-il pas une simple violence politique impérial s’appliquant sans mesure. Il y a, bien davantage, une dynamique de violence et de contre-violence entre le régime impérial et ceux qui en sont exclus. Et si ses institutions sont plus stables et pérennes que celles de la République romaine, l’Empire romain, dès la chute de Caligula, montre ses premières fragilités.
— Gauthier BOUCHET
BIBLIOGRAPHIE
- BARRETT (John). Caligula, the Corruption of Power, Londres/New-York, Routledge, 1989, 334 p.
- CASTORIO (Jean-Noël). Caligula, au cœur de l’imaginaire tyrannique, Paris, Ellipses, 2017, 477 p.
- COGITORE (Isabelle). La légitimité dynastique d’Auguste à Néron, à l’épreuve des conspirations, Paris, Broccard, 2002, 298 p.
- HURLEY (Donna). An Historical and Historiographical Commentary on Suetonius’ Life of Caius Caligula, Atlanta, Scholars Press, 1993, 230 p.
- MATYSZAK (Philip). The Sons of Caesar: Imperial Rome’s First Dynasty. Londres, Thames & Hudson, 2006, 296 p.
- NONY (Daniel). Caligula, Paris, Fayard, 1986, 437 p.
- PETIT (Paul). Histoire générale de l’Empire romain. Le Haut-Empire : 27 avant Jésus-Christ-161 après Jésus-Christ, Paris, Le Seuil, 1978, 307 p.
- RENUCCI (Pierre). Caligula, l’impudent, Gollion, Infolio, 2007, 223 p.
- SANDISON (A.). The Madness of the Emperor Caligula, in Medical History vol. 2:3, Cambridge, Cambridge University Press, 1958

